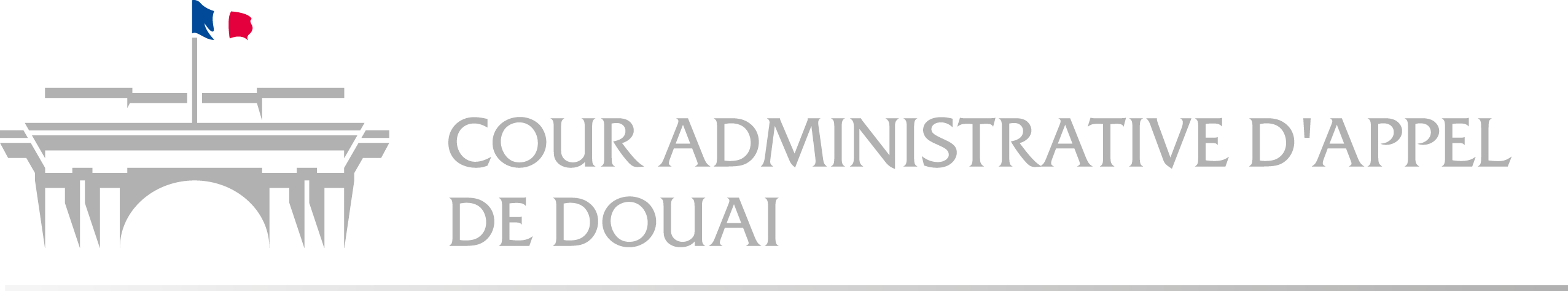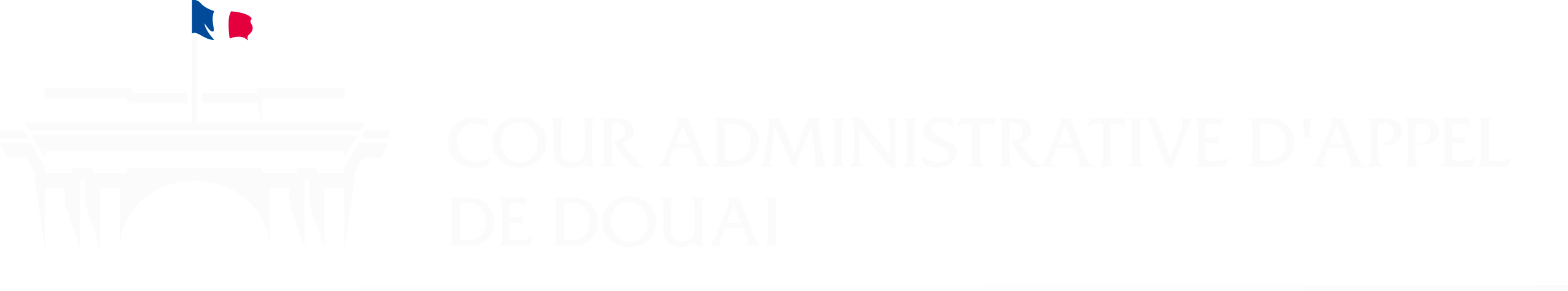Retrouvez le recueil des principales décisions que la Cour a rendues au cours de l’année écoulée ainsi que des décisions du Conseil d’État relatives au contentieux de l’asile. Cette année encore, nous avons jugé des questions importantes ou nouvelles tenant, notamment, à la protection des femmes et à l’appréciation des risques et précisé notre jurisprudence concernant les conditions de mise en œuvre des fins de protection.
Vous trouverez ci-après une rapide présentation de ces thèmes. Je vous invite, par ailleurs, à vous reporter au sommaire thématique pour retrouver l’ensemble des décisions ayant fait l’objet d’un classement en 2018.
La protection jurisprudentielle des droits des femmes ressort parmi les principales thématiques de l’année écoulée. La Cour a ainsi redéfini la notion de groupe social des femmes entendant se soustraire à un mariage forcé, élargi l’application du principe d’unité de famille et renforcé la protection des mineures invoquant un risque d’excision.
C’est en effet à l’occasion de deux recours émanant de jeunes femmes originaires de Guinée et du Mali que la Cour a jugé que les jeunes filles et les femmes qui entendaient se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituaient de ce fait un groupe social, dès lors que, dans leur communauté d’origine, le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale (cf. p. 58 et 62). La Cour a également élargi l’application du principe de l’unité de famille au conjoint ou concubin de la personne reconnue réfugiée dans le cadre d’une demande de réexamen, lorsque l’union est antérieure à cette demande de réexamen (cf. p. 112). Par ailleurs, la Cour s’est
fondée sur l’article L. 752-3 du CESEDA, qui prévoit qu’il ne peut être mis fin à la protection octroyée à une mineure invoquant un risque de mutilations sexuelles féminines sur la demande de ses parents tant que le risque de mutilation sexuelle existe. Dans ce cadre, elle a rappelé que les mutilations sexuelles féminines touchant encore la majorité des femmes issues des ethnies peule, soninké et bambara du Mali, il y avait lieu de conclure à l’absence de changement dans les circonstances qui avaient valu à une jeune fille d’être admise au statut de réfugiée (cf. p. 54). Toujours dans le cadre de la protection contre l’excision, la Cour a précisé que si les craintes d’une requérante devaient être examinées vis-à-vis de chacun de ses pays de nationalité, cela ne faisait pas obstacle à ce que la qualité de réfugiée soit reconnue à une requérante mineure qui serait exposée à un risque de mutilations sexuelles féminines dans un seul de ses deux pays de nationalité, dès lors qu’elle n’est pas en mesure, en raison de son jeune âge, de se réclamer de la protection de son autre pays de nationalité
(cf. p. 109).
Cette année encore, la Cour a veillé à ce que l’appréciation des risques se fasse toujours au regard d’un contexte géopolitique constamment actualisé.
La Cour a ainsi été amenée à préciser le cadre dans lequel devait être appréciée la notion de persécution fondée sur des opinions politiques dans le contexte spécifique du conflit armé prévalant en Afghanistan. Elle a ainsi reconnu que des opinions politiques pouvaient être imputées aux membres d’une institution d’État, telle que l’armée ou la police, par des groupes armés combattant le régime en place, rendant ces personnes, au cas d’espèce un membre de la police locale afghane, éligibles à la protection de la convention de Genève (cf. p. 38). Toujours au regard de la situation afghane et prenant acte de l’évolution de la relation entre les communautés hazara et les groupes taliban, telle qu’elle ressort de sources d’information publiques, variées et concordantes, la Cour a estimé que l’appartenance à la communauté hazara ne pouvait suffire à elle seule à fonder des craintes de persécutions vis-à-vis des taliban (cf. p. 44). Amenée à analyser si les changements intervenus au Sri Lanka apparaissaient significatifs au vu des sources d’information géopolitique fiables et pertinentes
dont elle disposait, la Cour a maintenu dans sa qualité de réfugié un ressortissant srilankais d’origine tamoule au motif que des violations graves des droits fondamentaux de l’homme qualifiables d’actes de persécution se produisaient encore dans ce pays, notamment à l’encontre de la communauté tamoule (cf. p. 206). Le Conseil d’Etat nous a également rappelé, dans le cadre de son pouvoir de juge de cassation, que l’appréciation des risques faite par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) devait être prise en compte par les formations de jugement. Ainsi, lorsque la CEDH conclut à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants, la Cour est dans l’obligation d’octroyer au requérant, à tout le moins, une protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-1 b) du CESEDA. Dans sa décision, le Conseil a tenu à préciser que, lorsque par un arrêt définitif la CEDH considère que la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement relève d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cela constitue pour le juge une circonstance nouvelle rendant recevable une demande de réexamen (cf. p.232).
Dernier thème marquant de l’année retenu ici, la Cour a renforcé son contrôle sur les conditions de mise en œuvre des fins de protection par l’OFPRA.
Ainsi, confirmant la décision de l’OFPRA, la Cour, réunie en grande formation, a mis fin au statut de réfugié d’un ressortissant russe d’origine tchétchène, condamné à une peine de dix-huit mois de prison en France, où il s’était livré à des actes de prosélytisme, de propagande et d’apologie de l’organisation terroriste dite « État islamique », avant d’être éloigné vers son pays d’origine, en application d’un
arrêté d’expulsion en urgence absolue. La Cour a jugé que l’absence de l’intéressé du territoire français, à la date à laquelle elle se prononce, ne faisait pas obstacle à l’examen de la menace pour la sûreté de l’État constituée par sa présence en France et à l’application de l’article L. 711-6, 1° du CESEDA (cf. p. 145). La Cour a jugé de même, s’agissant d’un ressortissant bangladais ayant diffusé une idéologie fondamentaliste auprès des fidèles d’une mosquée d’obédience radicale et ayant encouragé des activités de financement du djihad en Afghanistan (cf. p. 177).
Vous noterez enfin que nous sommes également passés, au cours de l’année 2018, à la rédaction en style direct, dans le souci de rendre nos décisions toujours plus claires et intelligibles. Les plus marquantes d’entre elles ont été mises en ligne sur le site Internet de la Cour tout au long de l’année.