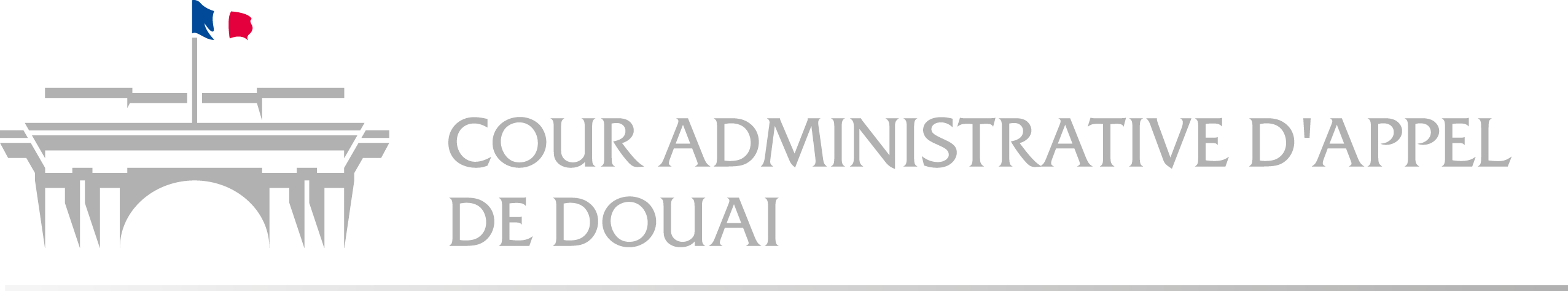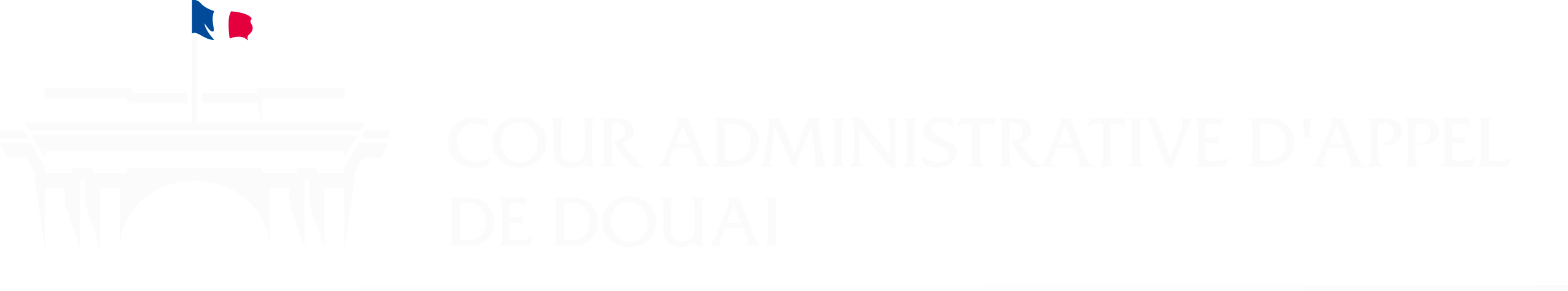Retrouvez le recueil des principales décisions que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rendues en 2019 ainsi que des décisions du Conseil d’État, notre juge de cassation.
L’année écoulée aura été marquée par nombre de décisions concernant, d’une part, la protection des personnes particulièrement vulnérables et, d’autre part, la vigilance accrue au regard de la protection de la sécurité publique.
Vous trouverez ci-après une rapide présentation de ces questions. Je vous invite, par ailleurs, à vous reporter au sommaire thématique pour retrouver l’ensemble des décisions ayant fait l’objet d’un classement en 2019.
La prise en compte des droits de l’enfant comme de ceux des femmes reste encore une thématique principale de l’année écoulée. Ainsi, s’agissant du risque d’exposition aux mutilations sexuelles féminines, la Cour a fait évoluer sa jurisprudence en adoptant une position de principe harmonisée quel que soit le pays d’origine. Par une décision de grande formation, la Cour a en effet réaffirmé que les enfants et jeunes filles exposés à un tel risque et se trouvant dépourvus de possibilités effectives de protection doivent se voir reconnaitre la qualité de réfugié. Cette décision précise également que si un taux élevé de prévalence au sein de l’ethnie d’appartenance ne pouvait que renforcer le risque d’exposition à cette pratique, il ne constituait pas pour autant un facteur indispensable à l’identification d’un risque sérieux, celui-ci pouvant être caractérisé au vu d’autres critères, tenant notamment aux traditions propres au groupe familial des jeunes filles (cf. p. 17 et p. 55) (CNDA GF 5 décembre 2019 Mmes N, S et S n° 19008524, 19008522 et 19008521 R).
En matière de mariages forcés, la Cour a à élargi sa jurisprudence en reconnaissant la qualité de réfugiée à une ressortissante de la Sierra Leone dont l’union, assortie de violences graves, lui avait été imposée afin de la punir de son orientation sexuelle non conforme (cf. p. 78) (CNDA 20 mars 2019 Mme K. n°18030347 C). Elle a également accordé le statut de réfugiée à une jeune femme ressortissante de la
République démocratique du Congo, issue d’une communauté où le mariage imposé et endogamique constitue une norme sociale (cf. p. 74 ) (CNDA 2 octobre 2019 Mme L. n° 19003209 C).
Par ailleurs, le Conseil d’État a confirmé la jurisprudence de la Cour selon laquelle les femmes nigérianes originaires de l’État d’Edo victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle constituent un groupe social, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, à la condition toutefois que ces femmes soient effectivement parvenues à s’extraire du réseau de prostitution (cf. p. 53 ) (CE 16 octobre 2019 Mme A. n° 418328 A).
Concernant la protection des mineurs étrangers, la CNDA a eu l’occasion de mettre en œuvre les nouvelles dispositions de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), issues de la loi du 10 septembre 2018. Celles-ci prévoient que lorsque des demandeurs majeurs se voient octroyer le bénéfice d’une protection, cette protection est également accordée à leurs enfants mineurs présents en France. Ce dispositif novateur permet en particulier d’étendre au descendant mineur le bénéfice de la protection subsidiaire (cf. p. 99 ) (CNDA 31 décembre 2019 Mme K, Mrs K. n° 19043332 C) Les situations de persécutions du fait d’une appartenance religieuse, celle-ci pouvant d’ailleurs recouvrir également des cas de convictions théistes ou athées a également donné lieu à de nouvelles
décisions. La Cour a ainsi mis en lumière la situation de la minorité ahmadie d’Algérie, considérée comme hérétique par les tenants de la religion d’État (cf. p. 48) (CNDA 4 juillet 2019 M. H. n° 19000104C). De même, la Cour a reconnu la qualité de réfugié à un moine bouddhiste vietnamien, d’origine khmère krom, détenu puis surveillé par les autorités vietnamiennes et craignant d’être à nouveau arrêté
pour propagande antigouvernementale (cf. p. 45) (CNDA 15 février 2019 M. T. n°18027282 C), ainsi qu’à un ressortissant centrafricain musulman d’ethnie haoussa menacé tant par des miliciens anti-balaka et des membres radicalisés de la population chrétienne de Bangui en raison de sa confession musulmane que par des éléments armés de son quartier lui imputant des opinions pro-chrétiennes (cf. p. 50) (CNDA
20 mars 2019 M. H. n°17004013 C).
Concernant l’octroi de la protection subsidiaire au titre des atteintes graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne ou international, au sens de l’article L. 712-1, c) du CESEDA, le juge de cassation a confirmé cette année la jurisprudence de la Cour selon laquelle même si la police nationale afghane n’est pas une force militaire, ses membres ne peuvent être considérés comme des civils et ne sont pas éligibles à cette forme particulière de protection. En l’absence d’un acte formel démontrant que l’intéressé a rompu tout lien avec cette institution, le seul départ du pays ne suffit pas pour permettre de les regarder comme ayant recouvré la qualité de civil (cf. p. 82 et p. 83) (CE 11 décembre 2019 M. M. n° 424219 B et CE
11 décembre 2019 OFPRA c. M. A. n° 427714 B).
Enfin, la Cour s’est attachée dans l’année écoulée à raffermir son contrôle sur les conditions de la perte ou du refus du statut de réfugié pour un motif de menace à l’ordre public. Tout en faisant application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne confirmant que les dispositions de la directive 2011/95/UE, transposées à l’article L. 711-6 du CESEDA, n’avaient pas pour effet de faire disparaître la qualité de réfugié précédemment reconnue2, elle a réitéré sa définition de la menace grave pour la société comme étant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave (cf. p. 146) (CNDA 26 juillet 2019 M. T. n° 17053942 C+). Le Conseil d’État a utilement précisé à cet égard, s’agissant de la menace grave pour la sûreté de l'État, que lorsque le requérant est inscrit au fichier des personnes recherchées ou lorsqu’une note blanche des services de renseignement français est versée au dossier, la Cour ne peut dénier une force probante à ces éléments qu’après avoir préalablement sollicité auprès du ministère de l’intérieur toutes informations pertinentes quant à leurs motifs (cf. p. 143 et p.145) (CE 30 janvier 2019 OFPRA c. M. G. n° 416013 A et CE 20 février 2019 OFPRA c. M. M. n°421212 C).
Par ailleurs, si la Cour accorde le bénéfice de la protection internationale aux victimes de la traite d’êtres humains à des fins de prostitution, elle veille à refuser ou à retirer cette protection aux acteurs des réseaux de traite. La grande formation de la Cour a ainsi jugé que la traite d’êtres humains était susceptible de constituer un agissement contraire aux buts et principes des Nations unies, au sens de l’article 1er, F, c)
de la convention de Genève, lorsqu’elle est le fait de groupes criminels organisés menaçant la sécurité internationale (cf. p. 55) (CNDA GF 25 juin 2019 Mme I. n° 18027385 R). Par la suite, la Cour a jugé qu’eu égard au haut niveau de responsabilité du requérant au sein du réseau transnational de traite d’êtres humains à des fins de prostitution qu’il dirigeait avec d’autres, il existait des raisons sérieuses de penser
qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, et qu’il devait donc être exclu du statut de réfugié (cf. p. 118) (CNDA 30 août 2019 M. A. n°18052314 C+).
Les décisions de la Cour figurant au recueil sont également consultables, dans leur version intégrale, sur le site internet de la CNDA.