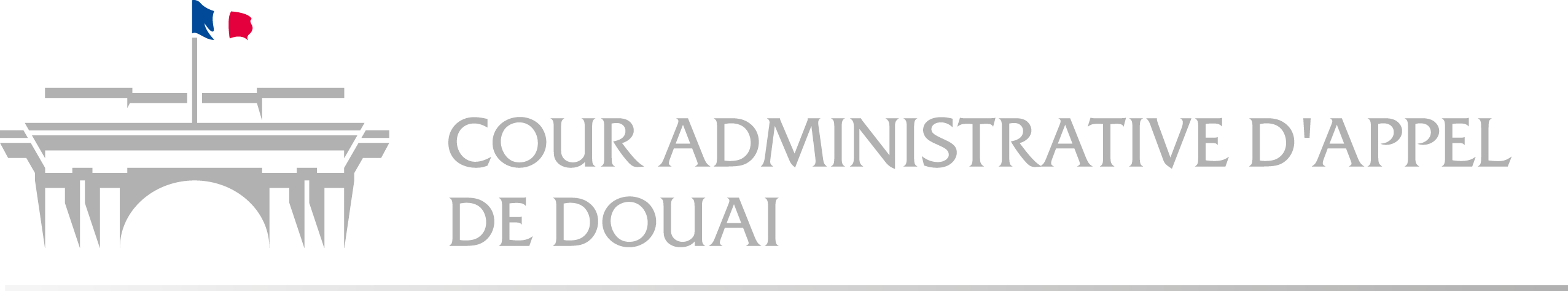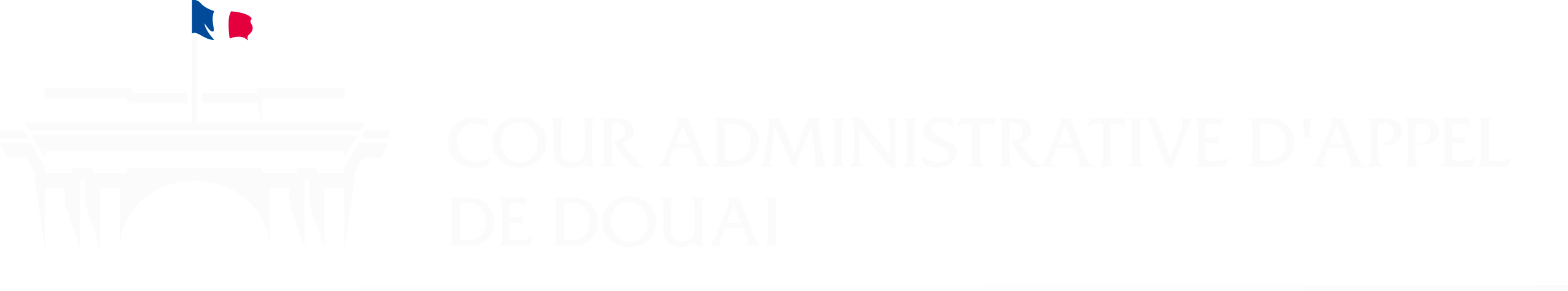Retrouvez le recueil des principales décisions que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rendues au cours de l’année 2020 ainsi que des décisions du Conseil d’État relatives à notre contentieux.
L’année écoulée a été marquée encore par l’indispensable protection des personnes en situation de vulnérabilité dans leur pays d’origine, ou encore de celles qui assument la défense des droits et libertés fondamentaux, mais aussi par la nécessité d’une vigilance accrue au regard de la sécurité publique. La CNDA s’est en outre attachée à fixer sa méthodologie quant à la prise en compte de l’évolutivité des données géopolitiques qu’elle traite, s’agissant notamment des situations de conflit armé.
Vous trouverez ci-après une rapide présentation de ces questions. Je vous invite, par ailleurs, à vous reporter au sommaire thématique pour retrouver l’ensemble des décisions ayant fait l’objet d’un classement dans l’année.
La CNDA a poursuivi en 2020 l’élaboration de sa jurisprudence relative à la notion de groupe social, en se dotant d’outils jurisprudentiels lui permettant une approche harmonisée quel que soit le pays d’origine. La Cour a ainsi reconnu la qualité de réfugiée à une enfant somalienne au vu des risques réels d’excision auxquels elle est exposée dans son pays, ces mutilations étant presque universellement pratiquées en Somalie (cf. p.22) (CNDA 1er septembre 2020 Mme A. n° 18053674 C+). Elle a aussi constaté pour la première fois l’existence d’un groupe social constitué par les jeunes filles et femmes refusant un mariage imposé ou tentant de s’y soustraire au sein de la communauté kurde d’Irak (cf. p.48) (CNDA 23 juin 2020 Mme R. épouse H. n° 17037584 C).
La Cour a également reconnu l’existence d’un tel groupe au Burkina Faso, dans le cas d’une femme appartenant à l’ethnie nankana dont le refus de se marier avec le frère de son mari défunt l’expose à l’opprobre de sa communauté et à des violences physiques (cf. p.45) (CNDA 4 septembre 2020 Mme K. n°19046460 C).
La Cour a également poursuivi sa tâche d’identification de l’existence dans les pays de groupes sociaux des personnes homosexuelles, s’agissant notamment du Kazakhstan (cf. p.57) (CNDA 28 mai 2020 M. K. n° 19051793 C) et du Liban (cf. p.52) (CNDA 29 mai 2020 M. C. n° 19053522 C).
S’agissant de la protection des libertés fondamentales, les défenseurs de ces droits peuvent être l’objet de persécutions, tant de la part des autorités des pays d’origine que de secteurs radicalisés de leurs populations. Le juge de l’asile a ainsi reconnu la qualité de réfugié à un ressortissant afghan qui faisait valoir des craintes personnelles liées notamment à sa fonction de directeur d’un centre d’enseignement des sciences pour femmes (cf. p.34) (CNDA 29 décembre 2020 M. G. n° 19031425 C+). La Cour a également eu recours au critère spécifique de l’asile constitutionnel lorsqu’elle a reconnu la qualité de réfugiée en raison de son action en faveur de la liberté à une universitaire kurde irakienne au parcours particulièrement emblématique d’un engagement fort pour la défense des droits des femmes, menacée et séquestrée par des membres de l’organisation État islamique (cf. p.31) (CNDA 17 février 2020 Mme A. n° 17049253 C+).
Toujours soucieuse des enjeux liés à la sécurité publique, la Cour a poursuivi la mise en œuvre des conditions d’application des dispositions de l’article L. 711-6 du CESEDA, qui permettent de refuser le statut de réfugié ou d’y mettre fin pour des raisons liées à la sauvegarde de l’ordre public. Si l’application de ces dispositions ne permet pas à la Cour de vérifier d’office que le requérant remplit toujours les conditions de la qualité de réfugié1, cette possibilité lui est en revanche offerte dès lors que l’OFPRA, au cours de la procédure contentieuse, fait valoir devant elle un autre fondement juridique mettant fin à cette qualité. Saisie par un réfugié russe d’origine tchétchène, la Cour a pu ainsi fonder sa décision de rejet, en application de l’article 1er, C, 1 de la convention de Genève, sur le fait que le requérant n’avait plus la qualité de réfugié, dès lors qu’il avait obtenu un passeport des autorités russes et s’était ainsi placé à nouveau sous leur protection (cf. p.164) (CNDA 28 décembre 2020 M. S. n° 20012065 C).
La Cour a également renforcé son analyse des législations et des pratiques institutionnelles des pays d’origine pour l’évaluation individuelle des demandes de protection internationale, en tenant compte de la manière dont les lois et règlements sont appliqués, entre autres faits pertinents à la date à laquelle elle statue. S’agissant de l’Érythrée, la recherche menée sur les pratiques administratives de ce pays a ainsi conduit la Cour à nuancer sa jurisprudence selon laquelle la présence d’Érythréens à l’étranger résulte nécessairement d’une sortie illégale du territoire perçue comme un acte d’opposition et de trahison vis-à-vis du régime en place (cf. p.61) (CNDA 19 février 2020 M. G. n° 18040316 C). La Cour a également été conduite à se positionner sur la situation des objecteurs de conscience sud-coréens en prenant en compte l’évolution institutionnelle favorable survenue sur cette question depuis quelques années (cf. p.28) (CNDA 18 décembre 2020 M. I. n°
19013796 C).
Enfin, par une grande formation du 19 novembre 2020, la Cour a relevé le défi d’accroître sa réactivité et son expertise dans l’appréciation des contextes intrinsèquement volatiles des situations de conflit armé, lesquels ouvrent droit au bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions de l’article L. 712-1 c) du CESEDA. Par cette jurisprudence, la Cour a précisé que l’évaluation du niveau de violence résultant du conflit armé exigeait le choix de sources conformes aux termes des directives européennes et respectueux des recommandations du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEEA). De fait, l’appréciation des motifs permettant l’octroi de cette protection implique la prise en compte de critères tant quantitatifs que qualitatifs, ceux-ci devant être appréciés au vu de sources publiques, pertinentes et actuelles à la date de la décision. Le nombre élevé de demandeurs d’asile potentiellement concernés avait rendu cette explicitation indispensable (cf. p.77 et p.69) (CNDA GF 19 novembre 2020 M. N. n° 19009476 R et CNDA GF 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R). Si l’enjeu, dans les affaires jugées, était l’évaluation du niveau de violence existant à Kaboul et dans d’autres régions d’Afghanistan à l’automne 2020, ces décisions prescrivent une méthode générale d’analyse permettant d’évaluer la situation dans tous
les pays d’origine frappés par des conflits armés, notamment la Somalie (cf. p.84) (CNDA 16 décembre 2020 M. Y. n° 20015807 C+).
Les décisions de la Cour figurant au recueil sont également consultables, dans leur version intégrale, sur le site internet de la CNDA.