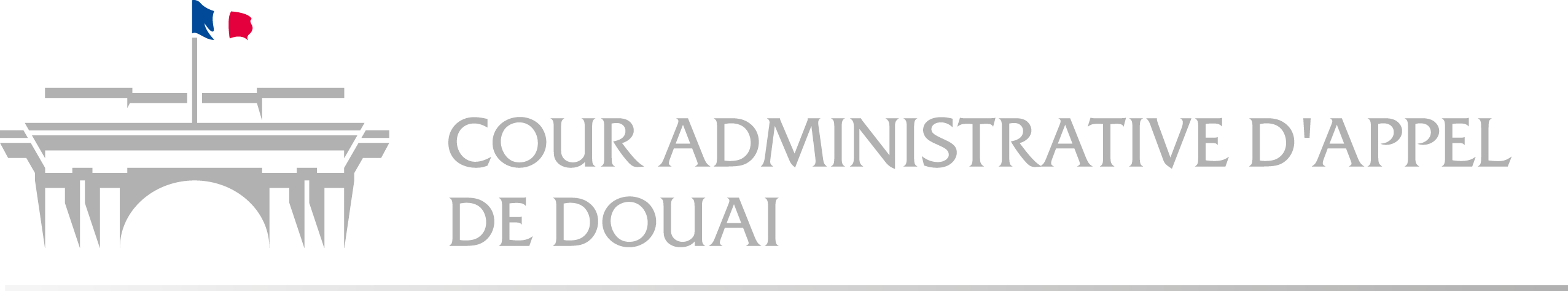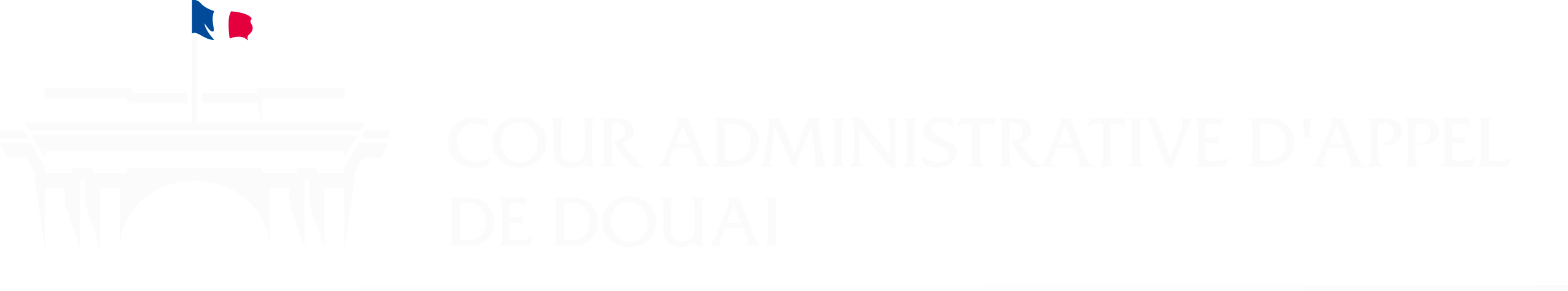Retrouvez le recueil des principales décisions que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rendues au cours de l’année 2021 ainsi que des décisions du Conseil d’État relatives à notre contentieux.
Le bilan de la contribution de la Cour à l’édification du droit d’asile durant l’année écoulée se révèle fort riche. Soucieuse de demeurer au plus près de l’actualité internationale, la Cour s’est attachée à porter une attention privilégiée à la protection des personnes en situation de vulnérabilité, en particulier les femmes et les enfants, comme à apporter une réponse harmonisée aux besoins de protection résultant des conflits armés et à veiller à ce que la protection internationale ne soit pas accordée ou maintenue à des personnes représentant une menace grave pour la sûreté de l’État ou la société française.
Par une décision inédite de portée générale et afin de prendre pleinement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, la CNDA a jugé que tous les enfants mineurs d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire doivent pouvoir bénéficier de cette même protection, y compris ceux qui sont nés après que cette protection lui a été accordée (cf. p. 208) (CNDA 14 octobre 2021 les enfants A. n° 21018964, 21018965, 21018966 et 21018967 R).
Parallèlement, la Cour a poursuivi l’édification de sa jurisprudence visant la protection des jeunes filles qui sont menacées d’excision. Elle a notamment reconnu réfugiée une enfant sénégalaise d’ethnie soninké née en France, le taux de prévalence de cette pratique demeurant très élevé au sein de cette ethnie (cf. p. 99) (CNDA 25 mars 2021 Mmes S. n°s 20006893 et 20006894 C). La Cour poursuit également son élaboration jurisprudentielle quant aux demandes émanant de jeunes filles ou de femmes soumises à des mariages précoces ou forcés. Elle a reconnu la qualité de réfugiée à une ressortissante ivoirienne du fait de sa soustraction à un tel mariage, assorti de surcroît d’une
menace de mutilation sexuelle féminine (cf. p. 91) (CNDA 29 mars 2021 Mme T. n° 20024823 C+).
Toujours confrontée à de nombreuses demandes se prévalant d’une situation de conflit armé dans le pays d’origine, la Cour a mis en œuvre les critères qu’elle avait dégagés à l’occasion de sa grande formation du 19 novembre 2020 et qui ont été validés par la décision du Conseil d’Etat du 9 juillet 2021 classée A (cf. p. 118) (CE 9 juillet 2021 M. M. n° 448707 A). Ainsi, la Cour a actualisé son appréciation du niveau de violence généré par le conflit en cours en Somalie, s’agissant de Mogadiscio et de la province du Benadir (cf. p. 141) (CNDA 5 février 2021 Mme A. n° 19032777 C+) ou de la province du Moyen-Shabelle (cf. p. 174) (CNDA 3 mars 2021 M. M. n° 20007059 C). Quant à la
province somalienne du Galgaduud, la Cour a déterminé qu’elle n’était pas affectée actuellement par une situation de violence aveugle engageant l’application de la protection subsidiaire (cf. p. 174) (CNDA 3 mars 2021 M. M. n° 20007059 C).
De même, dans le contexte du conflit armé sévissant au Mali, la grande formation de la Cour a jugé que le niveau de violence aveugle régnant dans la région de Mopti était exceptionnel au point que tous les civils y résidant étaient exposés à une menace grave contre leur vie ou leur personne du seul fait de leur présence sur ce territoire. Elle a aussi examiné à cette occasion la possibilité d’un asile interne pour ces personnes lorsque le conflit armé n’affecte pas l’ensemble du territoire national. Elle a considéré que, non seulement il y avait lieu de s’assurer que le demandeur pourra se rendre sans danger dans une partie déterminée du territoire, s’y établir et y mener une existence
normale, conformément aux jurisprudences du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel, mais aussi que le seul fait que le niveau de vie de l’intéressé diminue ou que son statut économique se trouve dégradé du fait de cette installation ne suffit pas à écarter la possibilité d’asile interne (cf. p. 122 ) (CNDA grande formation 15 juin 2021 M. S. n° 20029676 R).
En 2021, la Cour a également appliqué la protection subsidiaire à des conflits armés dont elle n’avait pas encore eu à connaitre. C’est ainsi que la juridiction a estimé que la province de Tillabéri au Niger, province frontalière avec le Mali et le Burkina Faso, connaissait une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité, du fait de l’implantation de groupes djihadistes armés (cf. p. 130) (CNDA 19 juillet 2021 M. M. et Mme A. n° 21008772 et n° 21008773 C+). Elle a également estimé que régnait actuellement dans la région éthiopienne du Tigré un niveau de violence aveugle d’exceptionnelle intensité (cf. p .136) (CNDA 30 avril 2021 M. B. n° 19050187 C+). La Cour s’est aussi prononcée sur le
niveau de violence aveugle résultant du conflit armé prévalant dans la province du Kasaï-Central de la République démocratique du Congo (cf. p. 191) (CNDA 15 janvier 2021 Mme E. n° 20003681 C +).
De même, afin de faire face à l’ampleur des enjeux suscités par le conflit afghan jusqu’à sa fin, le 15 août 2021, la Cour s’est attachée à déterminer les niveaux de violence dans les provinces, notamment, de Baghlān (cf. p. 155) (CNDA 9 juillet 2021 M. G. n° 20015236 C), de Kunduz (cf. p. 186) (CNDA 9 février 2021 M. B. n° 19055182 C), de Logar (cf. p. 181) (CNDA 9 février 2021 M. A. n° 19054630
C) et de Laghman (cf. p. 196) (CNDA 6 janvier 2021 M. N. n° 19054332 C). Si la prise de Kaboul par les taliban a eu pour conséquence la suspension de l’application de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA et l'augmentation concomitante des cas d’octroi de protection conventionnelle, la Cour a toutefois relevé que le séjour dans un pays occidental ne suffisait pas à entraîner, à lui seul, des persécutions de la part du nouveau régime (cf. p. 44) (CNDA 29 novembre 2021 M. A. n° 21025924 C+). Elle a jugé en revanche qu’eu égard à la permanence dans le pays d’un niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire, un état de particulière vulnérabilité était
susceptible d’exposer le demandeur à des traitements inhumains ou dégradants. De ce fait, le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à un requérant afghan au vu des graves problèmes de santé dont il a démontré être affecté (cf. p. 112) (CNDA 21 septembre 2021 M. A. n° 18037855 C+). La Cour a également dû actualiser son analyse sur les risques généraux pesant sur la communauté hazâra d’Afghanistan, en considérant que la prise de contrôle de l’ensemble du pays par les taliban ravive les risques sérieux et élevés de persécutions visant cette population (cf.p. 76) (CNDA 5 novembre 2021 M. S. n° 20025121 C).
Enfin, la Cour a poursuivi l’élaboration de sa jurisprudence relative à l’application de l’article L. 511-7 du CESEDA qui permet, pour des raisons liées à la sauvegarde de l’ordre public, de refuser le statut de réfugié à un demandeur d’asile ou de mettre fin au statut d’une personne ayant été reconnue réfugiée, au titre de la menace grave qu’elle représente pour la sûreté de l’État ou pour la société française. La Cour applique à cet égard la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle elle ne peut remettre en cause d’office la qualité de réfugié lorsqu’elle est saisie d’un recours formé contre une décision de l’OFPRA fondée sur l’article article L. 511-7 (cf. p. 269) (CE 30 mars 2021 M. S. n° 431792 C). En revanche, si elle est saisie par l’OFPRA, en cours d’instance, de conclusions visant à ce que 5 soit remise en cause la qualité de réfugié de l’intéressé, il lui appartient alors de vérifier que le demandeur répond bien aux conditions prévues à l’article 1er de la convention de Genève et à l’article L. 511-1 du CESEDA (cf. p. 256 ) (CE 9 novembre 2021 M. I. n° 439891 B).
S’agissant de protection subsidiaire, la Cour a confirmé la décision de l’OFPRA d’y mettre fin, en vertu des articles L. 512-3 et 512-2, 4° du CESEDA, dans le cas d’un ressortissant kazakh ayant commis de nombreux délits et actes de violence sur le territoire français après l’octroi de cette protection et dont elle a relevé le refus de faire l’objet d’un suivi psychologique ainsi que la personnalité antisociale entraînant l’impossibilité d’envisager une éventuelle insertion économique ou sociale (cf. p. 248 ) (CNDA 26 février 2021 M. A. n° 20035833 C).