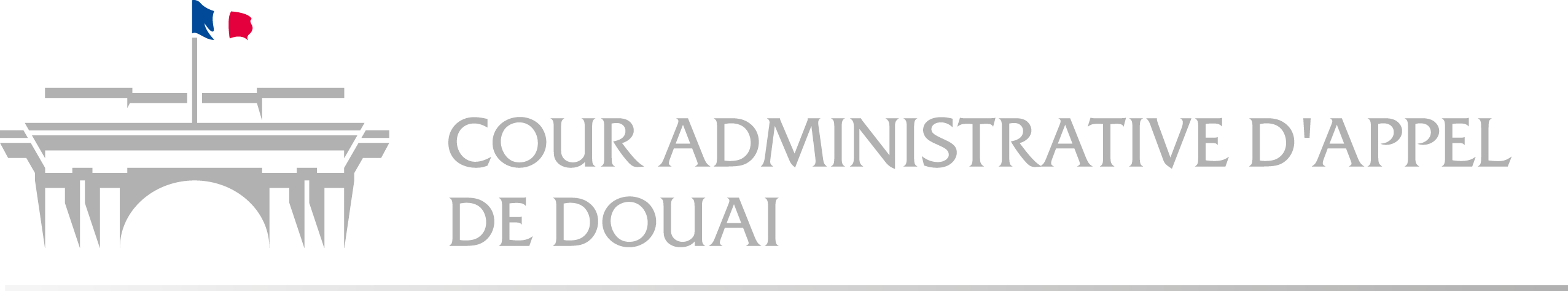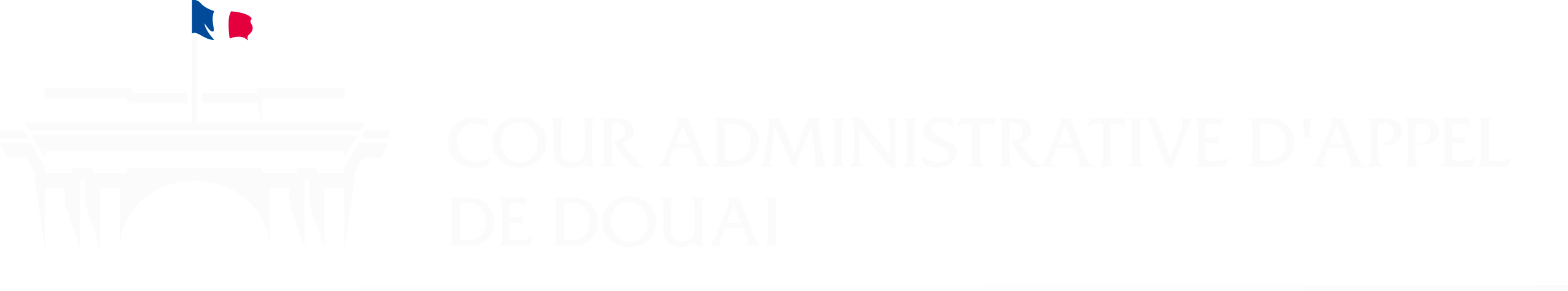Retrouvez le recueil des principales décisions que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rendues au cours de l’année 2021 ainsi que des décisions du Conseil d’État relatives à notre contentieux.
L’année 2022 a suscité d’importants apports jurisprudentiels concernant le contentieux de l’asile,
particulièrement quant aux questions relatives à la protection des familles des bénéficiaires de la
protection internationale, à celle des personnes menacées en raison de leur orientation
sexuelle et/ou identité de genre et aux besoins de protection spécifiques résultant des
conflits armés. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a également poursuivi
l’élaboration de sa jurisprudence s’agissant de la possibilité d’une protection sur une partie du
territoire du pays d’origine du demandeur. Elle s’est aussi prononcée sur la situation de personnes
refusant d’accomplir leurs obligations militaires ainsi que sur celle de personnes bénéficiant déjà
d’une protection internationale. Par des décisions inédites, le Conseil d’État a utilement explicité
les notions de crimes au sens de l’article 1er, F de la convention de Genève ainsi que la notion de
menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État, concernant l’exclusion
de la protection subsidiaire. Le juge de cassation a également précisé les cas où des demandes
d’asile doivent être regardées comme des demandes de réexamen.
Protection des familles des bénéficiaires de la protection internationale
La Cour réunie en grande formation a rappelé que le principe d’unité de la famille, principe général
du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève,
impose, en vue d'assurer pleinement aux réfugiés la protection prévue par cette convention, que
la même qualité soit reconnue notamment à la personne de même nationalité qui est unie par le
mariage à un réfugié ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié. Ce principe ne trouve toutefois pas
à s'appliquer dans le cas où la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié peut se
prévaloir de la protection d'un autre pays dont elle a la nationalité. Ainsi, le conjoint d'un réfugié,
qui possède la nationalité d'un autre pays dont il est en mesure d'obtenir la protection, ne peut
bénéficier du principe de l'unité de famille. Elle a ainsi réaffirmé que le conjoint d’un réfugié qui ne
possède pas la même nationalité que ce dernier ne peut pas bénéficier du principe de l’unité de
famille. De même, en l’absence de lien de filiation avec le réfugié, des enfants vivant auprès de ce
dernier ne peuvent davantage prétendre à l’application de ce principe ou de l’article L. 531-23 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) (cf. p.152) (CNDA grande
formation 22 décembre 2022 Mme K. et N. et M. n°s20029566, 20029567 et 20029589 R).
La Cour a également rappelé que la possession par un enfant entré mineur en France d’une
nationalité distincte de celle son parent réfugié ne faisait pas obstacle à l’application à son profit
du principe de l’unité de famille. Les trois jeunes filles requérantes se sont ainsi vu reconnaître la
même qualité que leur mère, réfugiée statutaire de nationalité guinéenne, alors qu’elles
possédaient aussi la nationalité canadienne (cf. pp.138, 157) (CNDA 8 avril 2022 Mmes B.
n°s20015144, 20015145 et 20015146 C+). De même, la compagne sans nationalité d’un réfugié de
nationalité éthiopienne bénéficie du principe de l’unité de famille dès lors que l’Éthiopie est son
pays de résidence habituelle (cf. pp.140, 156) (CNDA 4 mars 2022 Mme T. n°20011942 C+).
La CNDA a également rappelé que les enfants mineurs d’une personne dont la qualité de réfugiée
a été reconnue doivent être regardés comme titulaires de la même protection internationale que
la sienne. Ainsi, une décision de la Cour accordant à la mère de deux enfants mineurs la qualité de
réfugiée a également pour effet d’accorder cette protection à ces deux enfants même si leur nom
n’est pas mentionné dans la décision la concernant. Elle a ainsi considéré que le fait que la Cour n’ait
pas expressément protégé les deux enfants ne peut avoir d’influence sur le jugement de l’affaire
4
et n’ouvre pas la voie d’un recours en rectification d’erreur matérielle (cf. pp.156, 232) (CNDA 16
août 2022 Mme M. et MM. E. n°22009861 C+).
La grande formation a également jugé que la perte du statut de réfugié résultant de l’application
de l’article L. 511-7 du CESEDA met fin à la protection de l’unité familiale accordée au réfugié dont
l’objectif est d’assurer pleinement aux réfugiés la protection prévue par la Convention de Genève.
Ce retrait constitue donc un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de
la qualité de réfugié à son conjoint et à ses enfants mineurs. Il appartient toutefois à l’OFPRA puis,
le cas échéant à la Cour, d’apprécier si les intéressés doivent continuer à bénéficier de la protection
qui leur avait été accordée. Au demeurant, la personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre
de l’unité de famille est susceptible de continuer à bénéficier d’une carte de résident dès lors qu’elle
a été en situation régulière pendant cinq ans en application de l’article L. 424-6 du CESEDA (cf. p.152)
(CNDA grande formation 22 décembre 2022 Mme S. n°22024535 R).
Protection des personnes menacées en raison de leur orientation sexuelle et/ou identité
de genre
S’agissant de la protection des personnes socialement exposées justifiant la reconnaissance de la
qualité de réfugié sur le motif tiré de l’appartenance à un certain groupe social, la Cour a poursuivi
en 2022 l’établissement de sa jurisprudence en matière d’orientation sexuelle, en identifiant pour
la première fois l’existence d’un groupe social des personnes homosexuelles dans les pays
suivants : Afghanistan (cf. p.38) (CNDA 8 juin 2022 M. A. n°21050501 C), Irak (cf. p.48) (CNDA 10
novembre 2022 M. T. n°21011453 C), République du Congo (cf. p.41) (CNDA 13 mai 2022 M. M.
n°22000728 C), Tanzanie (Zanzibar) (cf. p.45) (CNDA 3 janvier 2022 M. A. n°21035853 C), Tchad (cf.
p.35) (CNDA 29 juin 2022 M. M. A. n°21067657 C), Tunisie (cf. p.57) CNDA 20 octobre 2022 M. R.
n°21060804 C) et Turquie (cf. p.53) (CNDA 2 novembre 2022 M. F n°22034674 C).
Par ailleurs, la Cour a reconnu pour la première fois l’existence du groupe social des femmes et des
enfants exposées au risque d’excision en Égypte, où cette pratique constitue une norme sociale, et
a reconnu à ce titre la qualité de réfugiée à une jeune fille originaire de la région du Delta (cf. p.60)
(CNDA 8 septembre 2022 Mme E. n°21059269 C). Le juge de l’asile est parvenu à une solution
identique dans le contexte de l’Éthiopie, en jugeant que les enfants et jeunes femmes d’ethnie
amhara non excisées constituent un groupe social et que l’intéressée, partiellement excisée, était
exposée au risque de faire l’objet de l’excision totale qui constitue la norme au sein de sa
communauté d’appartenance. La Cour a aussi retenu que la requérante craignait aussi avec raison
d’être persécutée pour s’être soustraite à un mariage imposé alors qu’elle était mineure. L’union
forcée de mineures restant massivement pratiquée dans le pays sans que les autorités la
combattent efficacement, les femmes et filles qui entendent se soustraire à un tel mariage en
Éthiopie constituent un groupe social au sens de la convention de Genève (cf. p.68) (CNDA 17 mai
2022 Mme J. n°21038022 C). De même, la Cour a identifié le groupe social des femmes irakiennes
entendant se soustraire à un mariage imposé dans leur pays (cf. p.63) (CNDA 21 juin 2022 Mme S.
épouse N. n°20002635 C).
Protections spécifiques résultant des conflits armés
En vue de l’application de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA aux ressortissants du Burkina Faso, la CNDA
a jugé pour la première fois par une décision classée C+ que la région du Sahel connaissait
actuellement dans ce pays une situation de violence aveugle d’une exceptionnelle intensité, de
sorte que l’octroi de la protection subsidiaire était justifié par les risques contre la vie ou la personne
induits par la seule présence de l’intéressé dans la région concernée, sans qu’il soit nécessaire de
retenir des facteurs d’individualisation particuliers. Après le Mali, puis le Niger, cette décision
illustre la propagation du conflit armé à l’ensemble des pays de la bande sahélienne (cf. p.117)
(CNDA 7 juillet 2022 M. O. n°21065121 C+).
Par ailleurs, la Cour a entrepris l’édification de sa jurisprudence concernant les niveaux de violence
aveugle provoquée par le conflit armé initié en Ukraine en février 2022. S’appuyant sur des données
5
publiquement disponibles, elle a conclu que, à la date de sa décision, le niveau de violence aveugle
généré dans les oblast de Donetsk, de Kharkiv, de Louhansk et de Zaporijjia était d’une
exceptionnelle intensité (cf. pp.103, 150) (cf. pp.86,149) (cf. pp.92, 149) (cf. pp.98, 150) (CNDA 30
décembre 2022 M. T. n°22001393 C+, CNDA 30 décembre 2022 Mme C. n°21060196 C+, CNDA 30
décembre 2022 Mrs A. n°s21063903 et 22002736 C+ et CNDA 30 décembre 2022 M. M. n°21048216
C+).
Possibilité d’une protection sur une partie du territoire du pays d’origine du demandeur
De plus, par ces mêmes décisions, la Cour a jugé que, dans la mesure où la totalité du territoire de
l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence
aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées à une persécution ou à une atteinte
grave de la faculté prévue par l’article L. 513-5 du CESEDA permettant de rejeter la demande d’une
personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une
partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle s’y
établisse.
La Cour a estimé, en revanche, que s’agissant d’un ressortissant nigérian menacé de mort dans
l’État de Kadouna à la suite de sa conversion de l’islam au christianisme, motif religieux de nature à
justifier une reconnaissance de la qualité de réfugié, il pourrait s’établir dans le sud du pays pour y
vivre dans des conditions d’existence normales et pérennes. Si l’intéressé faisait valoir qu’il y serait
exposé à la précarité économique, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas de raison de penser, en l’espèce,
que le requérant, adulte et bien portant, ne serait pas en mesure de subvenir à ses propres besoins.
Elle a ajouté qu’il était raisonnable de penser en outre, au vu de la pratique religieuse dont il se
réclamait, qu’il pourrait s’insérer dans une communauté religieuse et y créer des liens de solidarité
(cf. pp.31, 151) (CNDA 25 novembre 2022 M. A. n°21061849 C+).
Cas des personnes refusant d’accomplir leurs obligations militaires
Saisie par un demandeur d’asile turc d’origine kurde refusant d’accomplir ses obligations militaires,
la Cour réunie en grande formation définit l’objection de conscience au service militaire justifiant la
reconnaissance de la qualité de réfugié comme une réelle conviction personnelle, revêtant un
degré avéré de force ou d’importance, de cohérence et de sérieux, motivée par un conflit grave et
insurmontable entre l’obligation de service dans l’armée et sa propre conscience ou ses propres
convictions sincères et profondes, notamment de nature politique, religieuse, morale ou autre.
L’intéressé devra alors être en mesure d’apporter des informations étayées et personnalisées sur
la nature des raisons invoquées, les circonstances dans lesquelles il est venu à les adopter et la
manière dont ses convictions s’opposent, selon lui, à ce qu’il effectue son service militaire. Par
ailleurs, il ne résulte d’aucune source d’informations publique que les conscrits d’origine kurde
seraient victimes dans l’armée turque de discriminations ou de mauvais traitements de manière
significative et systématique lors de l’accomplissement de leur service militaire (cf. pp.73, 82) (CNDA
grande formation 7 juin 2022 M. C. n°21042074 R).
Cas des personnes bénéficiant déjà d’une protection internationale
Saisie par un demandeur déjà admis au bénéfice de la protection subsidiaire en Grèce alléguant
qu’en application de l’article 24 (1.) de l’« International Protection Act » (IPA) du 1er novembre 2019,
concernant les modalités de renouvellement du titre de séjour délivré au bénéficiaire d’une
protection internationale, l’expiration du titre de séjour entraînait la perte de la protection
subsidiaire, la CNDA relève que les dispositions de cet article ne permettent pas de déduire de
l’expiration d’un titre de séjour la fin ou l’ineffectivité de cette protection en Grèce (cf. p.160) (CNDA
24 novembre 2022 M. N. n°22000212 C+).
Cette décision est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle la personne à qui le
statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé par un État membre de
l’Union européenne ne peut pas, sans admission préalable au séjour en France, y revendiquer le
6
bénéfice des droits liés à cette protection tant que celle-ci est maintenue et effective dans l’État
considéré (cf. p.158) (CE 25 mai 2022 OFPRA c. M. M. n°451863 B).
La CNDA rappelle en revanche que lorsqu’un demandeur d’asile a été placé par le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) sous son mandat en vertu des articles 6 et
7 de son statut, la qualité de réfugié lui est reconnue automatiquement par l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, le cas échéant, par la Cour (cf. p.28) (CNDA 31 mai
2022 Mme A. n°20036087 C+).
Cas des personnes relevant d’une clause d’exclusion conventionnelle ou représentant une menace
grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État
S’agissant de la définition du crime de guerre au sens de l’article 1er, F, a) de la convention de
Genève, le Conseil d’État précise que ce crime peut consister en l’emploi de mines anti-personnel
lorsqu’il traduit l’exercice d’une violence indiscriminée impliquant des atteintes graves à la vie et à
l’intégrité physique de civils (cf. p.169) (CE 27 septembre 2022 M. B. n°455663 B).
De plus, le juge de cassation définit les conditions auxquelles le crime grave de droit commun visé
à l’article 1er, F, b) peut être qualifié de crime politique faisant obstacle à la clause d’exclusion pour
crime grave de droit commun. Pour porter cette appréciation, il convient de déterminer s’il existe
un lien direct entre l’acte commis et le but politique poursuivi et de mesurer l’adéquation et la
proportionnalité entre cet acte et ce but, au regard notamment des moyens employés, de l’exercice
ou non d’une violence anormale et indiscriminée et de la nature et du nombre des victimes (cf.
p.184) (CE 21 juin 2022 OFPRA c. M. O. n°447538 A).
Concernant l’exclusion de la protection subsidiaire, s’agissant de l’activité sur le territoire français
constituant une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État, au
sens de l’article L. 512-2, 4° du CESEDA, la Haute juridiction souligne que s’il y a lieu de tenir compte
de l’ensemble des agissements imputables au demandeur, il n’est pas nécessaire de rechercher
l’existence d’éléments matériels et intentionnels spécifiques à la commission d’un crime (cf. p.195)
(CE 22 avril 2022 OFPRA c. M. H. n°455520 B).
Cas de réexamen des demandes d’asile
Le Conseil d’État a dégagé en 2022 des critères complémentaires concernant les demandes d’asile
en réexamen, en application de l’article L. 531-41 du CESEDA. Constitue une demande de réexamen
une demande d’asile présentée par une personne qui a fait l’objet d’une décision définitive de refus
de protection de la part de l’OFPRA et qui est rentrée entre temps dans son pays d’origine (cf. pp.
19, 232) (CE 24 février 2022 M. D. n°446616 B). Constitue également une demande de réexamen
une demande d’asile présentée par une personne ayant fait l’objet précédemment d’une
décision définitive de fin de protection rendue par l’Office (cf. pp.21, 233) (CE 24 février 2022
OFPRA c. M. M. alias M. n°453619 B).
En outre, la Cour applique la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle la demande d’asile
formée pour le compte d’un mineur né après l’enregistrement de la demande d’asile de son parent
et déposée après la décision définitive de rejet de celle-ci est une demande de réexamen. Dans ce
cas, l’Office n’est pas tenu de procéder à un entretien lors de l’examen préliminaire de cette
demande (cf. pp.25, 234) (CNDA 10 mai 2022 Mme U. n°21050062 C+).